Aujourd’hui, en France comme en Europe, la biodiversité est en péril. Seuls 20 % des habitats terrestres (tourbières, prairies alpines...) et à peine 6 % des milieux aquatiques d’intérêt européen (herbiers de Posidonie, récifs coralliens…) sont aujourd’hui en bon état de conservation. Pire encore : 17 % des espèces de faune et de flore sont menacées ou ont déjà disparu. Face à l’urgence, l’Union européenne a adopté à l’été 2024 un règlement ambitieux sur la restauration de la nature, fixant des objectifs contraignants pour tous les États membres. Une avancée décisive que la Fondation entend défendre avec force, pour que la préservation de la biodiversité reste une priorité politique, territoriale et sociétale.
Restaurer la nature ça veut dire quoi ?
Restaurer la nature, c’est remettre en état des écosystèmes dégradés pour qu’ils retrouvent leurs fonctions essentielles : accueillir la biodiversité, filtrer l’eau, stocker le carbone… Cela peut passer par des mesures comme la suppression des pesticides mais aussi par la plantation de haies, la réouverture de cours d’eau ou la création de zones humides.
Mais restaurer la nature, ce n’est pas que protéger des espaces naturels. C’est aussi sécuriser notre alimentation future, améliorer notre santé, limiter les risques d’inondations ou de sécheresses et garantir un environnement vivable pour les générations à venir.
Concrètement aujourd’hui, face à la bétonnisation et aux canicules, la renaturation prend une importance nouvelle. Dans plusieurs villes de France, des parkings ou des friches ont été transformés en parcs et îlots de fraîcheur, où la température, lors d’une vague de chaleur, peut baisser de 5 à 10 °C par rapport à l’environnement minéralisé. On voit également fleurir des initiatives telles que la végétalisation de rues et de murs ou encore la restauration de rivières urbaines, améliorant à la fois la qualité de vie et la santé publique. Des projets concrets qui répondent à une attente forte des citoyens : la quasi-totalité des urbains jugent qu’il manque de nature dans leur quotidien, et soutiennent la plantation d’arbres et la création d’espaces naturels en ville.
Le règlement européen insiste sur la restauration de la nature, mais un autre terme est souvent employé : renaturation.
- La renaturation consiste à transformer des espaces artificialisés, comme d’anciens parkings ou des friches pour y recréer des espaces de nature. C’est une démarche de compensation de l’artificialisation des sols.
- La restauration écologique, elle, vise à réparer des écosystèmes déjà existants mais dégradés : zones humides, forêts, cours d’eau, prairies…
Autrement dit : la renaturation recrée de la nature là où elle avait disparu, tandis que la restauration redonne vie à ce qui existe encore mais fonctionne mal.
Restauration écologique : un tournant à ne pas rater !
Adopté à l’été 2024, le règlement européen impose des objectifs contraignants à tous les États membres :
- restaurer au moins 20%des terres et des mers de l’UE d’ici 2030 ;
- restaurer tous les écosystèmes dégradésd’ici 2050 ;
- concentrer les efforts sur les sites Natura 2000au moins jusqu’en 2030.
C’est un vrai tournant politique et écologique : la restauration de la nature devient une obligation, et non plus une simple recommandation. En France, la mise en œuvre de ce règlement passera par un Plan national de restauration de la nature (PNRN), attendu pour septembre 2026. Un premier temps de concertation publique a eu lieu entre mai et août 2025. Une concertation à laquelle la Fondation a participé en proposant un cahier d’acteurs sur la question des zones Natura 2000. La Commission nationale du débat public (CNDP) publiera sa synthèse dès septembre. Ensuite :
- le ministère apportera des réponses à l’automne 2025,
- une deuxième phase de participation citoyenne se tiendra jusqu’en juin 2026,
- le plan sera finalisé et transmis à l’Europe à la rentrée 2026.
Pour la Fondation pour que ce plan soit réellement efficace, il devra être résolument ambitieux et s’inscrire dans la continuité des politiques existantes en faveur de la biodiversité. Il devra aussi distinguer clairement la renaturation — qui compense l’artificialisation de nouveaux espaces dans le cadre du Zéro Artificialisation Nette — de la restauration écologique, qui vise à réparer en profondeur des milieux naturels dégradés. Enfin pour la Fondation, ce plan ne pourra réussir qu’à condition d’être décliné de manière concrète dans chaque territoire, en mobilisant pleinement les acteurs locaux, avec une gouvernance renforcée et des moyens humains et financiers à la hauteur de l’enjeu.
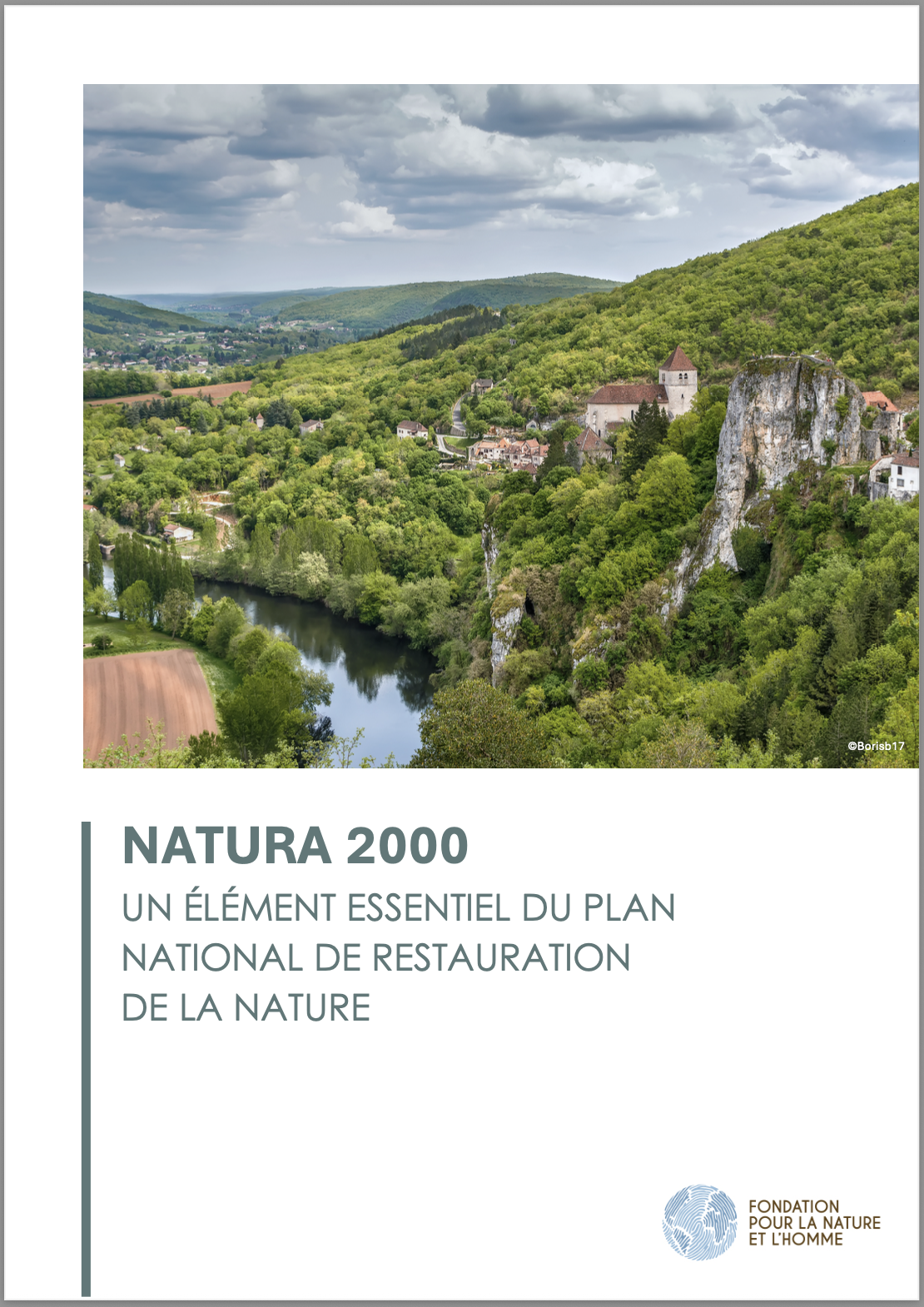
Le réseau Natura 2000 est le plus vaste réseau de protection de la biodiversité en Europe. Il compte en France plus de 1 700 sites et couvre 13 % du territoire.
Pourtant, malgré son ampleur, le réseau ne suffit pas aujourd’hui à stopper l’érosion de la biodiversité : seuls 20 % des habitats d’intérêt européen sont en bon état. Entre autres causes : des moyens humains et financiers trop faibles, et des pressions persistantes (intensification agricole, artificialisation des sols…).
Alors que le règlement européen fait des sites Natura 2000 une priorité de restauration d’ici 2030, plusieurs évolutions sont indispensables pour que les zones Natura 2000 jouent pleinement leur rôle dans l’atteinte de nos objectifs de restauration.
- Réorienter les financements publics : supprimer les subventions dommageables à la biodiversité et renforcer les moyens du réseau Natura 2000 dont les besoins s’élèvent à 652 millions d’euros.
- Mieux cibler les efforts : prioriser la restauration sur les zones et habitats les plus dégradés.
- Renforcer les moyens humains et techniques : former les animateurs de sites, améliorer la connaissance des milieux, accompagner les projets.
- Impliquer davantage les acteurs locaux : communes, agriculteurs, propriétaires fonciers, avec des outils de long terme comme les Obligations réelles environnementales (ORE).
L'article vous a été utile pour mieux comprendre cette actualité ?
Pour approfondir le sujet



