Est-il possible de proposer des logements abordables, sans bétonner davantage en Ile-de-France ? C’est la question à laquelle la Fondation souhaite répondre en s'associant à France Nature Environnement Ile-de-France (FNE IDF) et à la Fondation pour le Logement des Défavorisés (FLD) à travers une nouvelle étude à paraitre cette année. Une initiative qui s'inscrit dans la continuité des travaux menés par la Fondation pour promouvoir un urbanisme durable et socialement juste.
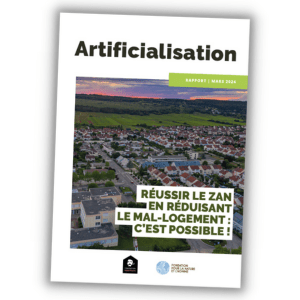
En Île-de-France, la tension foncière est telle qu’elle pourrait laisser croire à une incompatibilité entre lutte contre l’artificialisation et création de logements. Pourtant, concilier sobriété foncière et réponse au mal-logement est non seulement possible, mais nécessaire pour préserver la biodiversité et le cadre de vie des habitants. C’est tout l’enjeu de l’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN), dont cette région est un territoire clé d’expérimentation.
Un travail dans la continuité
En mars 2024, la Fondation avec la FLD, publiait un rapport démontrant que l'objectif Zéro Artificialisation Nette offrait une réelle opportunité de lutter simultanément contre l'artificialisation des sols et le mal-logement. Dans ce rapport, construit à partir de témoignages d’experts et de collectivités déjà engagées dans une politique de sobriété foncière, la Fondation proposait une large palette de leviers à disposition des territoires pour à la fois limiter l’artificialisation des sols et proposer une offre de logements abordables. Parmi eux : la résorption de la vacance des logements et des bureaux, la régulation des résidences secondaires, la densification douce ou encore la construction de logements peu consommateurs d'espaces naturels, agricoles ou forestiers.
Cette nouvelle étude, soutenue par la Fondation, a pour objectif de passer de la théorie à la pratique en mettant en évidence les opportunités réelles de production de logements sur le territoire francilien, sans avoir recours à l'artificialisation des sols.
Proposer des logements abordables tout en respectant les sols agricoles et naturels suppose un changement de paradigme. La densification douce, la réutilisation du bâti existant ou encore la transformation de friches sont autant d’alternatives concrètes à l’étalement urbain. Ces leviers permettent de préserver les espaces agricoles, forestiers et les écosystèmes locaux, tout en répondant à l’urgence sociale du logement.
L’Ile-de-France, une région clé de la lutte contre l’artificialisation
L'Île-de-France se trouve aujourd'hui confrontée à un défi majeur : concilier son développement urbain avec la préservation de ses espaces de nature. Cette région, la plus artificialisée de France métropolitaine avec 25% de son territoire bétonné, continue de perdre environ 774 hectares de terres chaque année, principalement en raison de la construction de logements. Cette artificialisation galopante a des conséquences alarmantes sur l'environnement et la qualité de vie des habitants, avec notamment 31% de la population vivant dans des zones classées comme îlots de chaleur.
Malgré son statut de région la plus artificialisée, l'Île-de-France bénéficie d'une dérogation à la loi Climat & Résilience, lui permettant de définir sa propre trajectoire de réduction de l'artificialisation des sols. Cependant, le nouveau schéma d'aménagement régional (SDRIF-E) propose une diminution de l'artificialisation qui reste insuffisante pour atteindre l'objectif national de zéro artificialisation nette (ZAN) d'ici 2050.
Face à cet enjeu majeur, la nouvelle étude FNE, FNH et FLD se concentre sur les solutions permettant de répondre aux besoins de logement en Île-de-France sans recourir à l'artificialisation des sols. En explorant des pistes telles que la densification du tissu urbain existant, la réhabilitation des friches ou l'optimisation des espaces déjà artificialisés, elle vise à proposer des réponses concrètes pour concilier les impératifs de développement urbain et de préservation de l'environnement.
Cette étude pourrait ainsi offrir un cadre précieux pour guider la région vers l'objectif ZAN, en démontrant qu'il est possible de répondre à la pression foncière et aux besoins croissants en logements tout en préservant la biodiversité et en améliorant la qualité de vie des habitants. Elle pourrait également servir de modèle pour d'autres régions confrontées à des défis similaires, contribuant ainsi à une approche plus durable de l'aménagement du territoire à l'échelle nationale.
En démontrant qu’il est possible de produire des logements sans recourir à l’artificialisation, l’Île-de-France peut jouer un rôle moteur. Elle deviendrait un modèle de planification territoriale intégrant biodiversité, justice sociale et sobriété foncière. Une dynamique à renforcer pour respecter les normes biologiques et les engagements climatiques nationaux.
Foire aux questions
Pourquoi l’Île-de-France est-elle une région clé pour le ZAN ?
Peut-on construire sans artificialiser en Île-de-France ?
En quoi consiste la densification douce ?
Quel est le lien entre mal-logement et artificialisation ?
Quels sont les impacts environnementaux de l’artificialisation ?
Le SDRIF-E est-il suffisant pour atteindre le ZAN ?
Que dit la loi Climat et Résilience sur l’Île-de-France ?
La réhabilitation des friches est-elle vraiment une solution ?
Pourquoi faut-il réguler les résidences secondaires en Île-de-France ?
Peut-on appliquer ce modèle à d’autres régions ?
Quel autre article lire sur ce sujet ?
Pour comprendre les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du ZAN dans les territoires et accompagner les collectivités dans leurs projets, nous vous invitons à lire Financer le ZAN : quelles solutions pour un foncier durable ?
L'article vous a été utile pour mieux comprendre cette actualité ?
Pour approfondir le sujet



