L’Île-de-France fait face à une double urgence : 1,3 million de Franciliens souffrent du mal-logement, tandis que la pression sur les sols naturels ne cesse d’augmenter, avec près de 700 hectares artificialisés chaque année. Dans ce contexte de fortes tensions, France Nature Environnement Île-de-France, la Fondation pour la Nature et l’Homme, et la Fondation pour le Logement des Défavorisés (anciennement Fondation Abbé Pierre) démontrent qu’il est possible de produire l’équivalent de 70 000 logements par an pendant dix ans, soit l’objectif annuel fixé à la région, sans consommer un seul mètre carré supplémentaire de terres naturelles ou agricoles. Cette estimation volontariste invite les acteurs locaux à se réunir, à se saisir des gisements identifiés dans l’étude et à repenser collectivement les modalités de production urbaine.
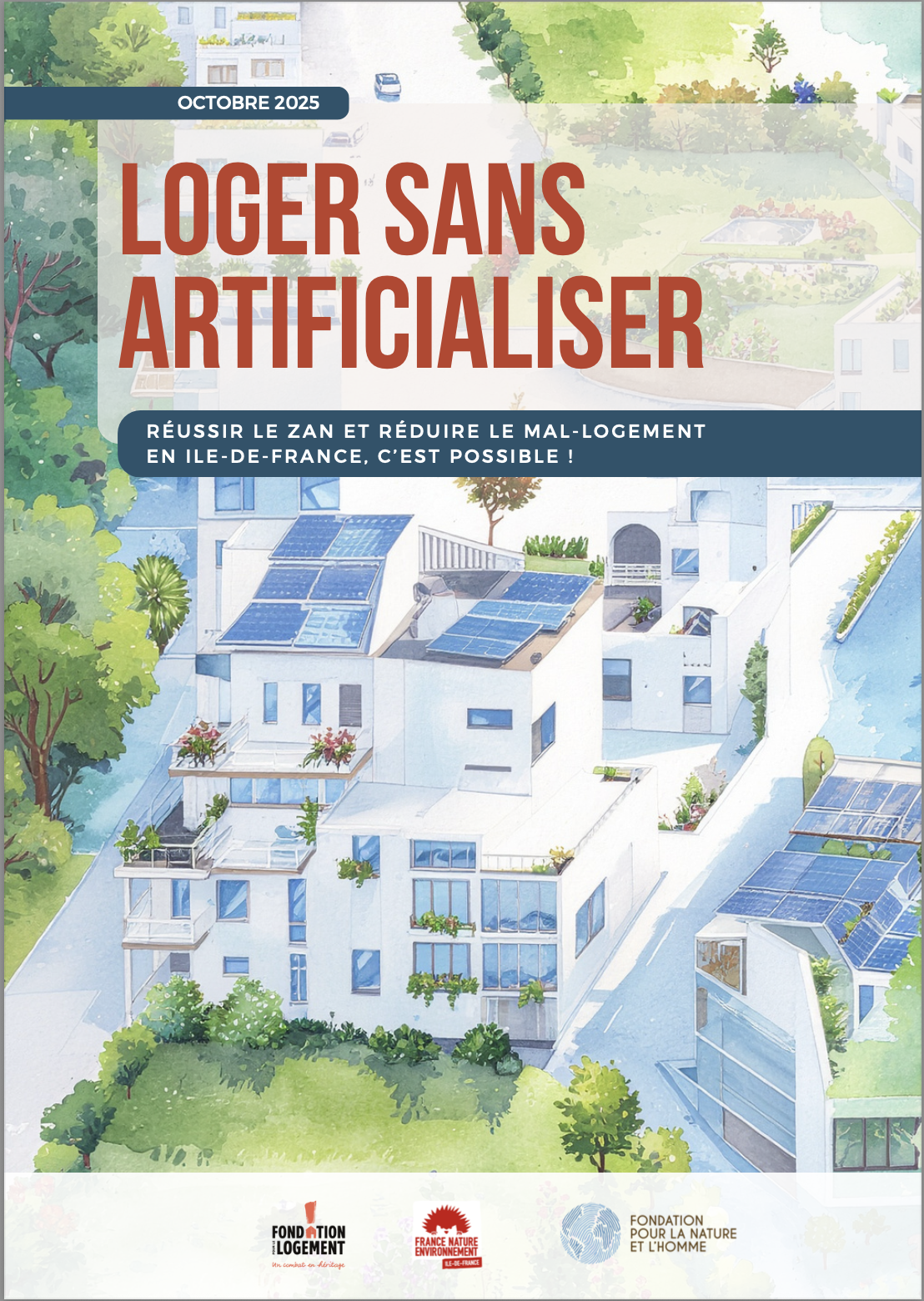
Zéro Artificialisation Nette : l’Île-de-France peine à avancer alors que les solutions sont là !
La trajectoire de l’Île-de-France en matière de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) se démarque par son manque d’ambition alors que 25 % de son territoire est déjà artificialisé (contre 9 % à l’échelle nationale). Le SDRIF-E, document stratégique d’aménagement régional, continue ainsi de miser sur l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation, compromettant biodiversité, stockage du carbone, production alimentaire et qualité de vie. Pourtant, l’étude démontre clairement que plusieurs réserves foncières et immobilières importantes sont déjà disponibles pour produire du logement sans consommer de terres naturelles ou agricoles :
- 112 000 logements grâce à la remise sur le marché de logements vacants ;
- 14 000 logements issus de la reconversion de bureaux vacants ;
- 60 000 logements via la revalorisation des friches ;
- 40 000 logements par la surélévation du bâti existant ;
- 30 000 logements par an pendant dix ans via une densification raisonnée des zones pavillonnaires.
Mobiliser les espaces sous-utilisés : un potentiel supplémentaire négligé
Au-delà des réserves foncières, l’étude met en avant un levier complémentaire majeur : l’optimisation des espaces déjà bâtis mais sous-utilisés. Cela concerne notamment les logements sous-occupés, les zones d’activités économiques peu exploitées, ou encore les résidences secondaires habitées quelques semaines dans l’année.
- Réduire de 25 % les résidences secondaires permettrait la création de 75 000 logements principaux ;
- La requalification des zones économiques pourrait engendrer 230 000 nouveaux logements ;
- La lutte contre la sous-occupation des logements libérerait plusieurs centaines de milliers de logements.
Pour que ce potentiel devienne réalité…
Il est indispensable de transformer l’intention en action. Cela suppose de mobiliser plusieurs leviers décisifs :
- Renforcer la coordination entre acteurs publics et privés, en impliquant pleinement collectivités, bailleurs sociaux, aménageurs et promoteurs dans une logique de co-construction ;
- Accompagner les communes, notamment les plus petites, dans une planification urbaine durable, en renforçant leurs moyens financiers et techniques, grâce notamment à une fiscalité ciblant les logements vacants et les résidences secondaires
- Associer les citoyens aux projets, grâce à des démarches de concertation ambitieuses, afin de garantir leur acceptabilité et leur ancrage local.
Soutenues par des politiques publiques claires en faveur de la sobriété foncière et de l’innovation urbaine, ces actions permettront de passer du gisement au projet, et du projet à la réalité.
Cette étude repose sur l’analyse des données statistiques disponibles et sur un corpus de 23 entretiens réalisés auprès d’experts et d’acteurs de l’aménagement, afin de croiser les points de vue et d’ancrer l’analyse dans les pratiques opérationnelles du secteur. Elle a été enrichie par 5 entretiens complémentaires avec des collectivités franciliennes, apportant des retours d’expérience précis. Enfin, un comité d’experts composé de Urbense, la DRIEAT Île-de-France, la DRIHL Île-de-France, l’AORIF et l’Apur a été mobilisé tout au long du travail pour examiner les données, consolider les estimations et conforter les hypothèses retenues.
L'article vous a été utile pour mieux comprendre cette actualité ?
Pour approfondir le sujet



