Nouveaux lotissements, routes, data centers, plateformes logistiques… Depuis plusieurs décennies, les chantiers se multiplient dans les territoires détruisant de façon quasi irréversible des refuges de biodiversité, des terres fertiles et des réservoirs de carbone. Cette problématique c'est l'artificialisation des sols !
Pour mieux comprendre tout ce qui se cache derrière cet enjeu complexe devenu une des priorités de la FNH, nous vous proposons notre nouveau guide à télécharger gratuitement.
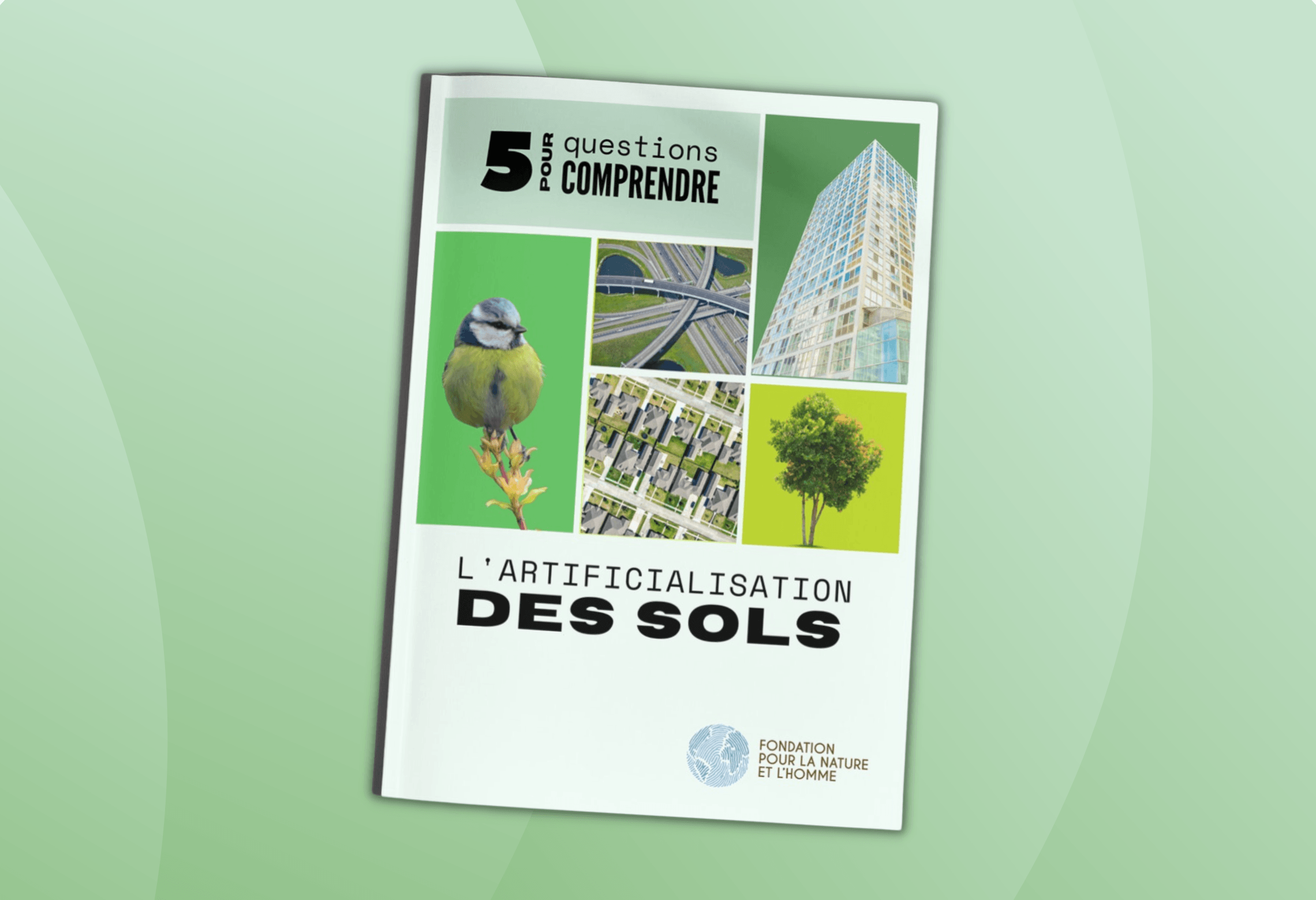
5 questions pour comprendre l'artificialisation des sols
1. Artificialiser un sol, qu'est-ce que ça veut dire ?
On a longtemps suivi le phénomène de l’artificialisation des sols en comptabilisant la perte de surfaces agricoles, naturelles et forestières due à l’urbanisation. Par exemple, un champ qui devient un lotissement, une route ou un centre commercial. Mais c'est seulement en 2021 avec la Loi Climat et Résilience que sera introduite une définition légale de l'artificialisation: “ L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.”
2. Quels sont les enjeux liés à la lutte contre l'artificialisation des sols ?
Un des enjeux majeurs de la lutte contre l'artificialisation des sols est la préservation de la biodiversité. En France, comme au niveau mondial, la rapidité avec laquelle les activités humaines détruisent la biodiversité est alarmante. Le taux d’extinction des espèces est aujourd’hui 100 à 1 000 fois plus élevé que celui observé jusqu’ici. Et l'étalement urbain n'y est pas étranger. Mais la lutte contre l'artificicialisation des sols c'est aussi une invitation à repenser notre rapport aux territoires, nos modèles d’organisation de l’économie et d’aménagement.
L’artificialisation des sols menace directement la préservation des sols naturels, qui jouent un rôle essentiel dans la régulation climatique, la biodiversité et l’alimentation. Pour faire face à cette pression, il est indispensable de repenser les logiques d’étalement urbain et de favoriser des formes d’urbanisme plus compactes et durables.
3. Quelle est la situation en France ?
En quarante ans, la surface artificialisée de la France métropolitaine est passée de 2,9 en 1982 à 5 millions d’hectares en 2018 (+72%). Cette artificialisation s’opère majoritairement aux dépens des terres agricoles : 2/3 de l’artificialisation entre 2006 et 2014 en France a eu lieu sur celles-ci. Mais tous les territoires ne sont pas égaux face à l’artificialisation. Le phénomène se concentre autour d’une minorité de communes surtout autour des grandes métropoles et du littoral.
Une planification écologique efficace doit tenir compte de ces disparités territoriales. La lutte contre l’artificialisation passe par des choix d’aménagement plus sobres, adaptés aux besoins locaux, et compatibles avec les objectifs de transition écologique fixés au niveau national.
4. Qu'est-ce-que le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) ?
En France, le travail de la Convention citoyenne pour le climat a abouti à l’adoption d’une loi, dite loi Climat et résilience. Celle-ci comprend des mesures importantes pour réduire l’artificialisation, notamment l'objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) ! Il demande aux territoires d'atteindre un équilibre entre les surfaces des sols qu’on artificialise et celles qu’on renature (i.e. Restaurer les fonctionnalités écologiques en créant des habitats favorables pour le vivant : mares, prairies, haies, cours d’eau, etc.) d'ici à 2050.
5. Quelles solutions pour freiner ce phénomène ?
Dans le cadre de son action de plaidoyer la FNH porte différentes propositions pour protéger et réaffirmer les ambitions du ZAN, tout en dotant les différents acteurs des bons outils. Mais chacun peut agir à son niveau : citoyens en proposant par exemple des projets collectifs de désimperméabilisation et de végétalisation des sols (www.jagisjeplante.org), entreprises en questionnant notamment l’opportunité des projets d’aménagement et collectivités bien sûr en hiérarchisant et en faisant des choix entre les projets d’urbanisation à l’aune des besoins sociaux du territoire et des objectifs de transition écologique.
Pour enrayer durablement le phénomène, il est crucial d’inscrire la politique du zéro artificialisation nette dans les priorités des collectivités. Cela implique de renforcer les outils d’aide à la décision, de mutualiser les bonnes pratiques et de mieux coordonner les acteurs à l’échelle des territoires.
Foire aux questions
Qu’est-ce que l’artificialisation des sols ?
Pourquoi faut-il lutter contre l’artificialisation des sols ?
Comment fonctionne la politique de zéro artificialisation nette ?
Quels sont les impacts de l’étalement urbain ?
Quelles solutions pour préserver les sols naturels ?
En quoi la planification écologique est-elle utile ?
Quels sont les sols les plus touchés ?
Tous les territoires sont-ils également concernés ?
Les citoyens peuvent-ils agir contre l’artificialisation ?
Les entreprises ont-elles un rôle à jouer ?
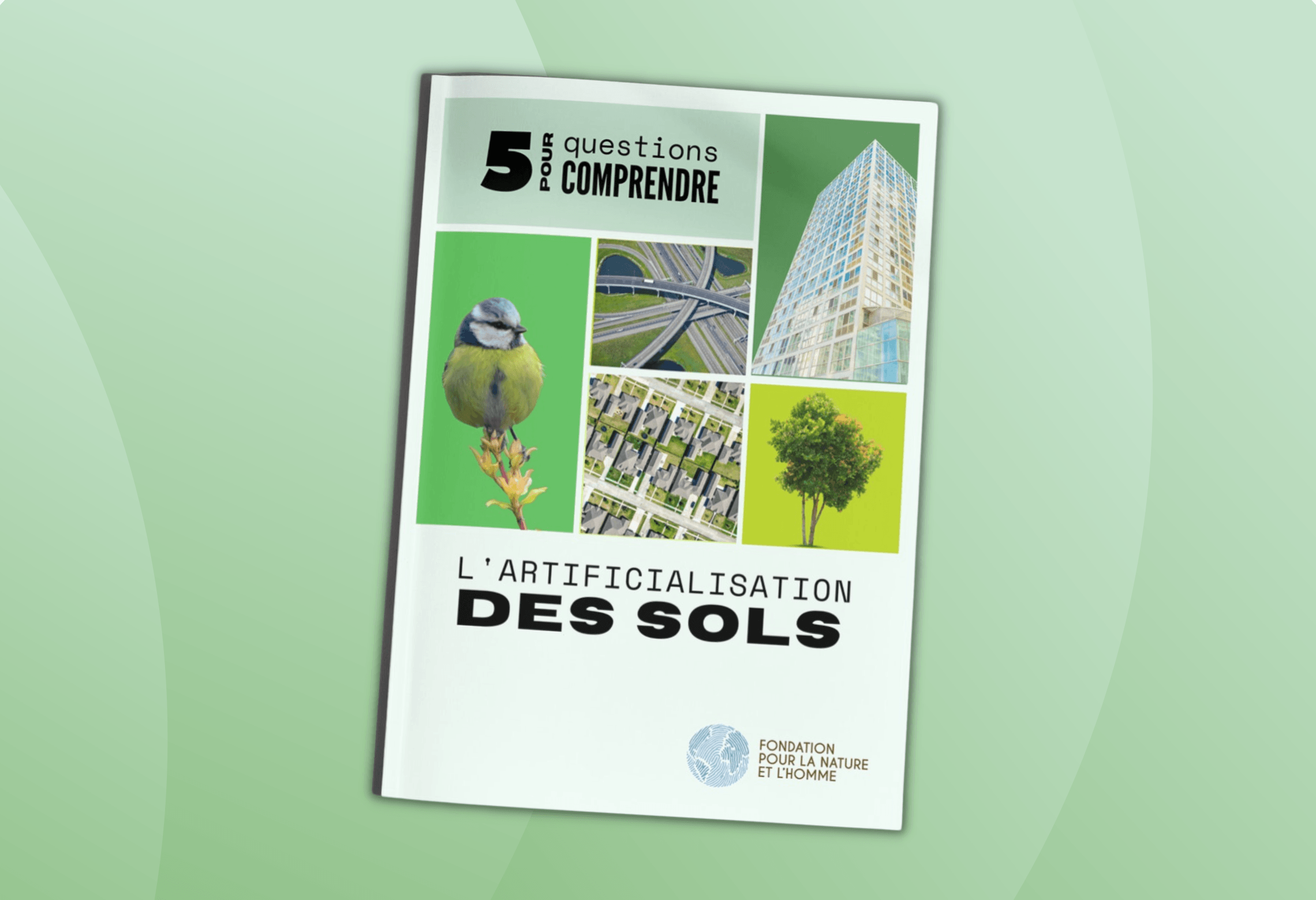
L'article vous a été utile pour mieux comprendre cette actualité ?
Pour approfondir le sujet



